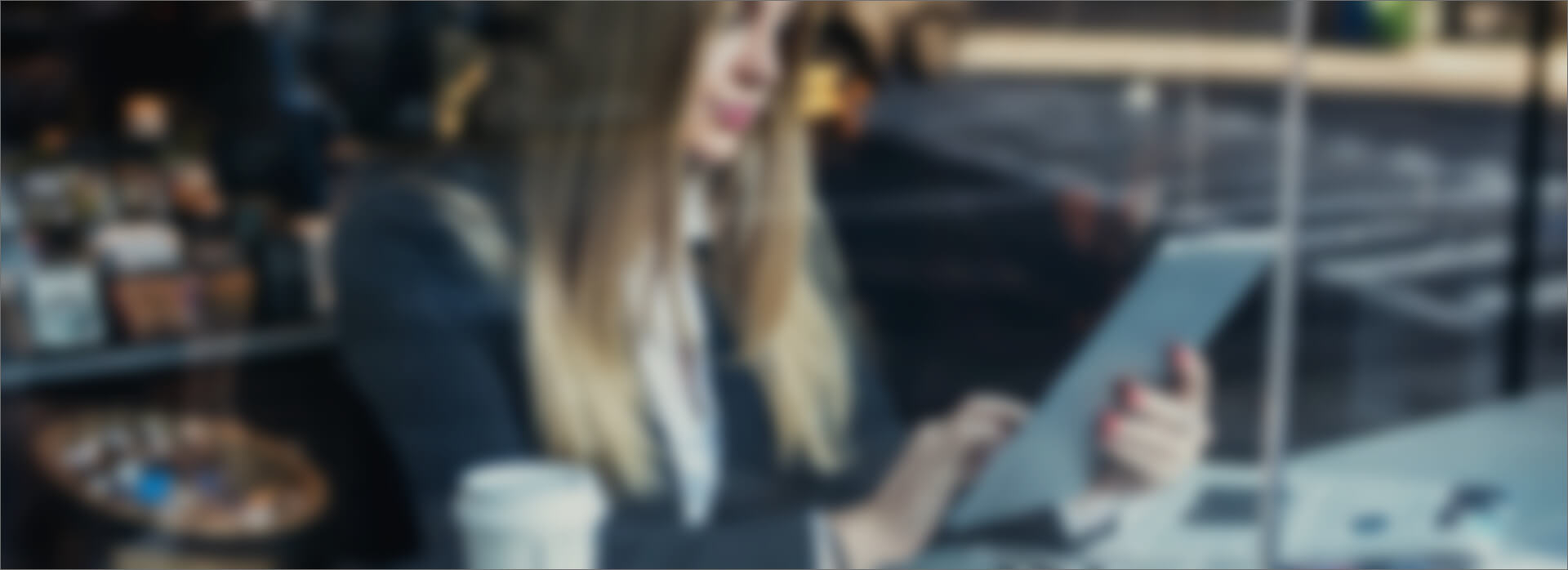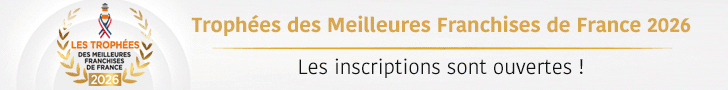Plus de huit ans après la fermeture de son point de vente, une ex-franchisée obtient en appel la requalification de son contrat de franchise en contrat de gérance de succursale. Les magistrats de Nîmes lui refusent toutefois une grande partie des indemnités qu’elle réclamait.
 Sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d’appel de Nîmes s’est prononcée le 3 mars 2025 dans un litige portant sur la requalification d’un contrat de franchise en gérance de succursale.
Sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d’appel de Nîmes s’est prononcée le 3 mars 2025 dans un litige portant sur la requalification d’un contrat de franchise en gérance de succursale.
Le litige éclate fin 2016, lorsque la société de la franchisée est placée en liquidation judiciaire.
« Épuisée » par cinq ans de travail « sans avoir pu se verser de salaire », estimant avoir été victime du « manque de rentabilité chronique du concept » et s’être « heurtée à un mur » quand elle sollicitait un dialogue, « écœurée », l’exploitante dépose le bilan et ferme son magasin.
En 2017, elle saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir le statut de gérante de succursale ainsi que des rappels de salaires et des indemnités au titre de la rupture du contrat à laquelle elle estime avoir été contrainte.
Pour la franchisée, la politique commerciale imposée par le franchiseur est responsable de son échec
Comme une soixantaine d’autres franchisées de ce même réseau avant elle, la plaignante affirme que le franchiseur « impose une politique de prix et une politique commerciale qui lui sont bénéficiaires » mais qui s’avèrent être « catastrophiques pour les adhérentes de son réseau ».
Si elle se retrouve « ruinée », c’est, à son avis, du seul fait de son franchiseur.
Pour celui-ci au contraire, l’échec de sa partenaire n’est dû qu’à ses propres fautes de gestion. Il n’a d’ailleurs commis lui-même aucun manquement à ses obligations et n’a pas, non plus, imposé ses prix de revente.
Une procédure déjà longue passée par la Cour de cassation

Par un arrêt du 3 juillet 2024, la plus haute juridiction française casse « en toutes ses dispositions » l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 septembre 2022 et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes.
Pour écarter les demandes de la franchisée, les magistrats de Montpellier avaient considéré – à l’instar du franchiseur – que, dans la mesure où le contrat de franchise n’avait pas été signé par la gérante personne physique mais par sa société, elle ne pouvait pas être concernée par les dispositions de l’article L. 7321-2 du code du travail qui ne sont pas applicables à une personne morale.
Pour la Cour de cassation cependant « dès lors que les conditions (de la requalification du contrat de franchise en gérance de succursale) sont réunies, les dispositions du code du travail sont applicables », que le franchisé ait signé le contrat en tant que personne physique ou en tant que représentant légal de sa société.
La cour d’appel de Nîmes requalifie le contrat de franchise en gérance de succursale
La cour d’appel de Nîmes juge donc à nouveau l’affaire au fond.
Pour elle, il n’y a pas de doute. La franchisée a « fait la démonstration qu’elle vendait des produits fournis exclusivement ou presque exclusivement par la (société du franchiseur) et qu’elle exerçait son activité dans un local agréé et aux conditions et prix imposés par (cette même société), ce qui caractérise le contrat de gérant de succursale ».
Aux yeux des juges, la plaignante rappelle notamment, « sans être contredite » par la partie adverse, que le franchiseur « prélevait jusqu’à 70 % du chiffre d’affaires » du point de vente et que l’essentiel de l’activité y provenait bien de la vente des marchandises fournies.
Par ailleurs, la commerçante a « versé aux débats une centaine d’attestations de salariées de plusieurs (franchisées) tendant à démontrer que le système mis en place par la société (franchiseur) est le même depuis près de vingt ans et qu’il est imposé à tous les (points de vente) du réseau. »
Les magistrats relèvent ensuite que la société franchiseur ne conteste pas avoir agréé le local dans lequel la franchisée a exploité son concept.
Les magistrats jugent notamment que la franchisée n’était pas réellement libre de sa politique de prix

La défense de la franchisée a, par exemple, fait acheter la même semaine par une centaine de personnes deux produits de l’enseigne dans une centaine de magasins différents du réseau et a pu établir que les tarifs pratiqués étaient tous identiques au centime d’euro près.
Pour les juges de Nîmes, même si le franchiseur affirme « n’avoir jamais imposé ses prix de revente » à sa partenaire, « il n’est pas fait la démonstration qu’en pratique cette faculté pouvait être et a été exercée en sorte qu’en réalité, (la franchisée) ne disposait d’aucune liberté concrète pour pratiquer ses propres tarifs. »
Ils relèvent par exemple que « la (gérante) n’avait pas la possibilité matérielle de paramétrer le logiciel de caisse pour appliquer une politique personnelle de prix, la procédure pour modifier ponctuellement un prix (étant) volontairement complexe. »
Conséquence : la cour requalifie le contrat et condamne la société franchiseur à verser à son ancienne franchisée près de 52 000 euros nets au titre de rappels de salaire (de directrice de succursale) pour la période « non prescrite » allant de décembre 2013 à décembre 2016.
Si elle accorde des rappels de salaire, la cour refuse de considérer qu’il y a eu licenciement
En revanche, sur la rupture du contrat, les magistrats ne considèrent pas, contrairement à la franchisée, qu’il s’agit d’un « licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Ils la déboutent de ses demandes d’indemnités à ce titre (de l’ordre de 76 000 €).
Pour eux, comme pour le franchiseur, cette rupture s’apparente à une « démission » n’ouvrant droit à aucune compensation. Car la franchisée « échoue à démontrer » que le contrat devait s’arrêter du fait de « manquements graves » de la tête de réseau.
Pour se décider ainsi, les magistrats suivent l’argumentation du franchiseur selon laquelle la franchisée et son associé – malgré deux exercices bénéficiaires – ont « opéré de mauvais choix dans la gestion » de leur société. Avec « des charges externes et des frais de personnel trop élevés pour le chiffre d’affaires réalisé » au vu des ratios du réseau.
L’arrêt relève aussi que la franchisée a « refusé une modification des conditions financières de son contrat » qui lui aurait permis – selon le franchiseur – d’obtenir 2 % de marge supplémentaire en passant son taux de commission de 35 à 37 %.
La franchisée restait « libre de la gestion de son fonds de commerce », estime la cour
Certes, les juges reconnaissent que la franchisée était soumise « à de nombreuses exigences » et à une « immixtion du franchiseur dans sa commercialisation et la présentation de son local ». Mais ils ne vont pas jusqu’à admettre que l’impossibilité de déterminer elle-même sa politique de prix l’a peut-être empêchée d’améliorer son chiffre d’affaires, base première de ses difficultés.
Ils retiennent au contraire qu’elle restait « libre de la gestion » du fonds de commerce dont elle était propriétaire en termes de « recrutement de salariés, acquisition de matériel, approvisionnement, souscription de crédit-bail… »
La cour note encore que le franchiseur « n’imposait (à la franchisée) aucun approvisionnement minimum, n’avait pas décidé du choix de l’emplacement du point de vente (même s’il l’a validé), ni de sa politique sociale et managériale. »
« Il n’est ainsi rapporté la preuve d’aucun manquement de la société (franchiseur) à l’origine des difficultés de la franchisée », concluent les magistrats.
La cour d’appel de Nîmes livre ici, au final, une décision mitigée qui – ne satisfaisant pleinement aucune des deux parties – pourrait bien, après celle de la cour de Montpellier, être soumise à son tour à l’examen de la Cour de cassation…