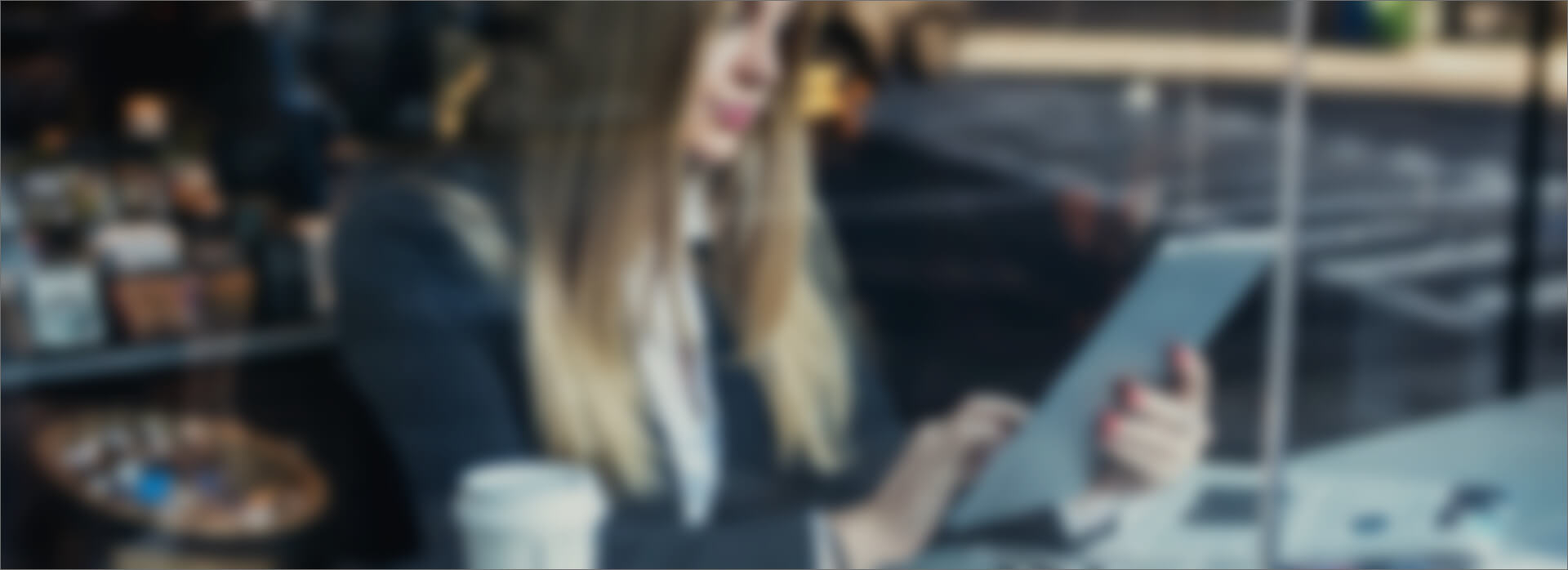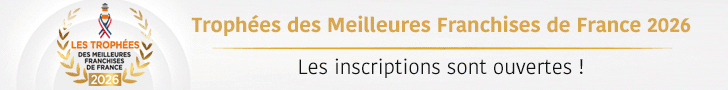Après avoir résilié son contrat, un concessionnaire assigné en justice par son ancien concédant se défend. Il réclame la requalification du contrat de concession en contrat de franchise et d’importants dommages et intérêts pour défaut d’assistance. Il est débouté de ses principales demandes. Le concédant aussi.
 La cour d’appel de Paris s’est prononcée en juin 2025 dans un litige concernant un jeune réseau.
La cour d’appel de Paris s’est prononcée en juin 2025 dans un litige concernant un jeune réseau.
Dans cette affaire, un contrat de concession de 5 ans est conclu début 2019 par une enseigne créée deux ans plus tôt et un entrepreneur.
Mission est donnée à celui-ci de développer dans sa région un réseau d’agents commerciaux pour une activité de services.
Le concessionnaire s’acquitte d’un droit d’entrée de 22 536 € TTC pour la réservation du département du Rhône et par un avenant de novembre de la même année, l’exclusivité est élargie à cinq autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Tout semble se dérouler normalement pendant deux ans.
Un concessionnaire insatisfait résilie son contrat deux ans après sa signature
Mais le 16 septembre 2021, le concessionnaire adresse au dirigeant du réseau un énième mail de mécontentement, un peu plus grave que les précédents. Il se plaint de l’insuffisance de la communication nécessaire au recrutement des consommateurs finaux.
Il critique le site internet de l’enseigne qu’il juge « vieillot » et « peu pratique », les mandats « trop compliqués à rédiger » et « facilement résiliables » et regrette de « percevoir moins que dans son précédent poste ».
Il ajoute qu’il ne « restera pas dans le réseau si rien ne change » et déclare attendre beaucoup d’une prochaine rencontre.
Puis le 12 octobre suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, il notifie au concédant la « résiliation de plein droit » de son contrat avec effet 30 jours plus tard.
Son concédant réclame 200 000 € de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme
En janvier 2022, le concédant l’assigne en justice pour concurrence déloyale et parasitisme, lui reprochant d’avoir utilisé sa marque après le contrat et d’avoir désorganisé son réseau en poussant à la démission une trentaine d’agents commerciaux.
En décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris condamne le concessionnaire à certains paiements, mais ne donne pas non plus entière satisfaction à la tête de réseau qui fait appel.
Devant la cour d’appel de Paris, la société concédante demande que la résiliation du contrat soit considérée comme abusive et que la société concessionnaire soit notamment condamnée à lui verser plus de 200 000 € au titre de la concurrence déloyale.
Le concessionnaire demande la requalification en contrat de franchise et 200 000 € d’indemnisation
Le concessionnaire réclame en riposte la requalification du contrat de concession en contrat de franchise.
Selon lui, le concédant a manqué de loyauté à son égard, car s’il n’a pas signé de contrat de franchise, c’était en réalité pour échapper aux obligations d’assistance qui y sont liées.
En conséquence, il demande la condamnation de son ex-partenaire à lui rembourser le montant du droit d’entrée versé et à s’acquitter notamment de 200 000 € de dommages et intérêts pour compenser « les investissements réalisés en pure perte ».
Il souhaite aussi que sa rupture du contrat soit considérée comme ayant été régulière pour faute de l’autre partie.
Pas de contrat de franchise selon la cour, car le savoir-faire était insuffisamment élaboré
La cour refuse d’abord de requalifier le contrat de concession en contrat de franchise.
Certes, reconnaissent les magistrats, des éléments de savoir-faire existaient au moment où le contrat a été signé, ainsi qu’une formation initiale pour les transmettre.
Mais ils se réduisaient pratiquement à un logiciel-métier permettant le suivi de la « production » de chaque agent commercial. Ce qui n’est pas suffisant « pour constituer le savoir-faire requis dans un contrat de franchise ».
Le contrat précisait d’ailleurs, relèvent encore les juges, que « seule la marque (était) concédée (car) à ce jour, les conditions requises notamment au titre du savoir-faire identifié et substantiel ne sont pas réunies et le concessionnaire est parfaitement informé qu’il ne conclut pas un contrat de franchise basé sur une quelconque réitération du succès ».
Le concessionnaire savait d’ailleurs, selon le concédant, qu’il était l’un des premiers à signer.
Et peu importe que la société concédante se soit présentée sur les sites internet spécialisés et dans au moins un Salon comme se développant en franchise, cela « n’est pas de nature à modifier la qualification juridique » de l’accord conclu.
Conséquence : « en l’absence de requalification du contrat », la cour rejette les demandes d’indemnisation du concessionnaire pour préjudice moral, puisqu’il n’y a pas eu selon elle de déloyauté du concédant lors de la conclusion du contrat.
De même, elle refuse de lui accorder les dommages et intérêts qu’il réclamait pour « manquement » de son partenaire à son « obligation d’assistance », puisque celui-ci n’y était pas tenu, n’étant pas franchiseur.
Pour la cour, le concessionnaire a résilié son contrat de manière abusive

Dans sa lettre de résiliation du 12 octobre 2021, il invoquait trois inexécutions contractuelles justifiant à ses yeux sa décision : « L’absence d’assistance à l’ouverture, soit la visite d’une journée sur place de la tête de réseau, l’absence d’assistance après l’ouverture, soit deux réunions par an en région et une au siège et l’absence d’assistance au cours du contrat sous la forme d’une convention annuelle du réseau ». Tous engagements contractuels non tenus.
La cour relève d’abord que le concessionnaire n’a pas respecté les formes prévues au contrat en cas de résiliation. A savoir l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception indiquant un délai pour la réponse du partenaire.
De plus, le mail du 16 septembre ne « définissait aucune inexécution contractuelle » et « ne constitue (donc) pas une interpellation suffisante pour constituer une mise en demeure. »
Or, sans mise en demeure, la résiliation d’octobre 2021 ne peut pas être considérée comme régulière.
« L’obligation d’assistance n’est pas essentielle dans un contrat de concession »
Les juges ajoutent que la lettre de résiliation se fondait sur la non-exécution de l’assistance par le concédant. Or, celui-ci a prouvé à leurs yeux « l’organisation de réunions en visioconférence, compte tenu du contexte sanitaire (lié au Covid), et d’échanges nombreux via la messagerie WhatsApp ».
En outre, cette obligation d’assistance n’est « pas essentielle dans un contrat de concession ».
Et la société concessionnaire ne démontre pas non plus « qu’il y aurait eu urgence, ni que l’exécution du contrat n’était plus possible ou les inexécutions irrémédiables. »
La résiliation du contrat de concession n’étant pas validée, les magistrats déboutent le concessionnaire de sa demande de remboursement du droit d’entrée versé pour le département du Rhône et le condamnent à s’acquitter de cette même « redevance initiale forfaitaire » pour les autres départements, soit un montant de plus de 46 000 € TTC.
Quant à la société concédante, puisqu’elle n’a pas réclamé de dommages et intérêts pour résiliation abusive, le concessionnaire n’est pas condamné à lui en verser.
Pas de concurrence déloyale du concessionnaire après le contrat selon la cour
La cour condamne en revanche le concédant à régler au concessionnaire deux factures à hauteur au total de plus de 17 000 TTC correspondant à des commissions dues sur le chiffre d’affaires réalisé avant la résiliation.
Par ailleurs, les magistrats écartent la demande du concédant concernant la concurrence déloyale du concessionnaire après la fin du contrat.
D’abord parce qu’aucun engagement de non-concurrence n’avait été conclu entre les deux parties.
La société concessionnaire pouvait donc poursuivre son activité. « Et la résiliation du contrat, même abusive, n’est pas en soi un acte de concurrence déloyale ».
Ensuite parce que, si les lettres de démission des agents commerciaux ont bien toutes été rédigées selon un même modèle fourni par la société concessionnaire, « il n’est pas prouvé », selon la cour, que celui-ci les ait pour autant « incités à démissionner ».
Et la société concédante est « mal fondée » à invoquer une désorganisation de son réseau alors que, sur les 30 agents commerciaux démissionnaires, seul l’un d’eux « était actif c’est-à-dire générait des résultats » au moment de la rupture.
La cour condamne le concédant pour dénigrement fautif et atteinte à l’image du concessionnaire
Enfin, les juges d’appel confirment la condamnation du concédant pour dénigrement de son ancien partenaire.
La société concédante a en effet, dans des courriels adressés aux membres du réseau et à d’anciens membres, annoncé la « rupture brutale » des deux parties, ce qui est, selon la cour, « une réalité », mais elle a aussi – pour expliquer la procédure judiciaire entamée – évoqué un « défaut d’éthique et de loyauté » du concessionnaire à son égard.
Pour les juges, il s’agissait là d’un « jugement de valeur disproportionné » « dépourvu de base factuelle suffisante ». Il y a donc bien eu « dénigrement fautif portant atteinte à l’image de la société concessionnaire ».
Les magistrats réduisent toutefois la sanction financière de 20 000 € à 10 000 €.