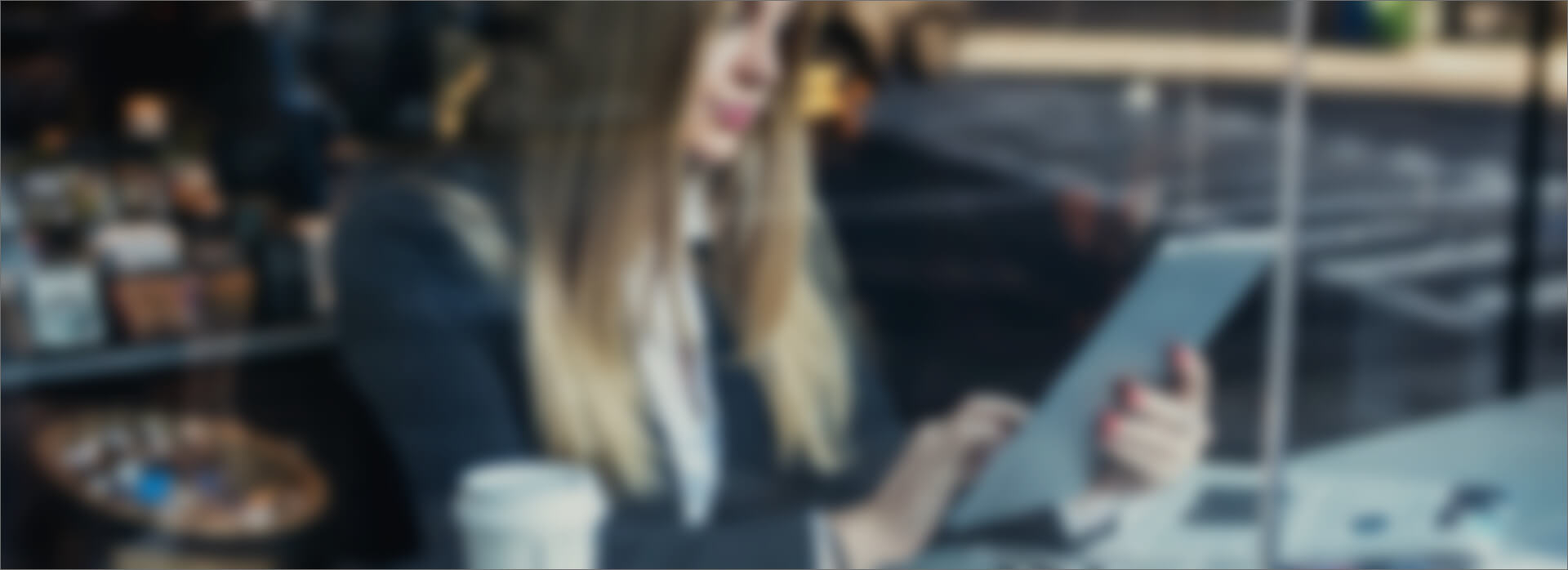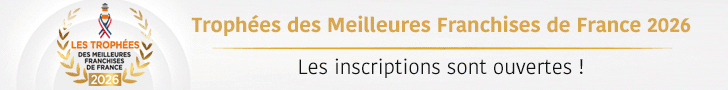Un franchisé refuse pendant plusieurs années de payer ses redevances, estimant que son franchiseur en difficultés manque gravement à ses obligations contractuelles d’assistance et de gestion de sa marque. Il est condamné à compenser en partie le préjudice financier subi par son partenaire.
 La cour d’appel de Rennes a jugé récemment un litige franchiseur-franchisé dans lequel chaque partie accusait l’autre « d’avoir gravement manqué à ses obligations contractuelles ».
La cour d’appel de Rennes a jugé récemment un litige franchiseur-franchisé dans lequel chaque partie accusait l’autre « d’avoir gravement manqué à ses obligations contractuelles ».
Dans cette affaire, un premier contrat de franchise de 5 ans est signé en 2007 et renouvelé pour 7 ans en 2012. Il ira jusqu’à son terme en 2019.
Mais lors de l’exécution du second contrat, les relations se tendent entre les deux partenaires.
Dès 2015, le franchisé cesse de communiquer les éléments permettant à l’enseigne de calculer le montant de ses redevances, qu’il ne verse plus.
Quant au franchiseur, il est, en mai 2016, placé en liquidation judiciaire et sa société absorbée en avril 2018 par celle d’un repreneur extérieur à son secteur d’activité, ce qui inquiète plusieurs franchisés.
Le franchisé demande la résolution de son contrat aux torts exclusifs du franchiseur
Après diverses procédures, en avril 2023, le franchiseur assigne le franchisé en justice, estimant avoir subi de sa part un important préjudice financier.
Un an plus tard, le tribunal de commerce de Rennes condamne le franchisé à verser 110 000 € à son ancien partenaire. Le franchisé fait appel.
Devant la cour, il demande l’annulation de sa condamnation et la résolution du contrat à compter du 1er janvier 2017 aux torts exclusifs du franchiseur, pour défaut d’assistance et mauvaise gestion de l’image de marque du réseau.
Le franchiseur réclame pour sa part que le franchisé soit condamné à 280 000 € au titre du préjudice économique et financier subi du fait des redevances impayées, 100 000 € de préjudice d’image et moral du fait des « critiques publiques » du franchisé, 50 000 € de dommages et intérêts pour « concurrence déloyale » et enfin 70 000 € (montants arrondis) au titre du non-respect de sa clause de non-concurrence post-contractuelle.
Pas de manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles, selon les juges, pour avoir transmis sans son accord le contrat du franchisé au repreneur du réseau
La cour écarte d’abord les arguments du franchisé tendant à prouver que son contrat de franchise serait nul, entre autres parce qu’il a été signé en 2007 par une société en cours de constitution ou parce qu’il a été transmis en 2018 au franchiseur-repreneur sans l’accord du franchisé alors que celui-ci s’était engagé précisément « en fonction de la personne du franchiseur ».
Sur le premier point, les magistrats relèvent qu’une fois constituée, la société franchisée a signé plusieurs avenants se référant au contrat initial. Il n’y a donc « pas lieu » selon eux « d’examiner la question de la nullité ».
Sur le second point, ils soulignent que le contrat de franchise prévoyait explicitement la possibilité pour le franchiseur de modifier unilatéralement ses structures juridiques et financières, la nouvelle entité se substituant à l’ancienne dans tous ses droits et obligations.
Certes, note la cour, la même liberté n’était pas accordée au franchisé. Mais c’était, note-t-elle, « la volonté » des parties.
En tout cas, pour les juges, « le fait que la société franchiseur ait été restructurée à travers une opération de fusion avec transmission universelle du patrimoine ne constitue pas un manquement (à ses) obligations (contractuelles). »
Pas de défaut d’assistance de la société franchiseur selon les magistrats
La cour d’appel écarte ensuite les arguments du franchisé réclamant la résolution du contrat aux torts exclusifs du franchiseur pour défaut d’assistance.
Certes, elle reconnaît quelques manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles en la matière – du type d’un retard dans la communication de la liste des fournisseurs – mais elle estime qu’ils « ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier d’une résiliation du contrat de franchise, ni pour justifier d’une absence de paiement des redevances par le franchisé ».
Selon les juges, si la société franchiseur a traversé des difficultés avec notamment un manque de personnel au siège à disposition des franchisés, « elle a mis en place des réponses pour y remédier ». Elle a aussi régulièrement « communiqué des informations » et organisé « des formations » pour les franchisés.
Des échanges de courriels montrent aussi que le franchiseur était disponible pour visiter ses franchisés et a notamment répondu rapidement à des demandes de documents du plaignant qui l’en a remercié.
Et quand son placement en procédure collective a eu des incidences sur les relations des franchisés et de leurs clients avec les banques, le franchiseur est intervenu « rapidement » pour « permettre le déblocage » des dossiers de financement.
Par ailleurs, si le franchisé a pu trouver des fournisseurs lui proposant des prix moins élevés que ceux négociés par le franchiseur, il n’a pas prouvé que les prestations proposées étaient du même niveau de qualité.
Pour les juges, il n’y a donc pas eu de la part du franchiseur de manquements contractuels graves sur le plan de l’assistance.
Pas d’atteinte grave à l’image de marque du réseau pour la cour
Concernant l’image de marque du réseau, la cour écarte aussi les arguments du franchisé.
Certes, plusieurs franchisés ont eux-mêmes été placés en liquidation judiciaire et le franchiseur n’a pas communiqué suffisamment pour rassurer leurs clients sur la livraison des prestations auxquelles ils s’étaient engagés. En outre, des articles de presse quotidienne régionale s’en sont fait l’écho.
Mais, pour les juges, même « s’il peut être reproché au franchiseur de ne pas avoir communiqué » sur le sujet, il n’est pas prouvé que « ces publicités, négatives, aient eu une grande diffusion et aient nuit au réseau ».
Quant aux affaires judiciaires engagées contre les dirigeants de la société franchiseur (père et fils) pour escroquerie et abus de confiance, portant sur des faits passés concernant d’autres enseignes du même secteur, « elles ont été relatées dans la presse et ont connu une publicité certaine », reconnaît la cour.
Mais « aucune condamnation n’est intervenue avant la fin du contrat » objet du litige et « aucune référence à la marque » du réseau n’a été mentionnée dans l’article cité au procès.
En résumé, pour la cour d’appel, « la publicité négative faite à la marque (…) n’était qu’indirecte et était peu, voire pas diffusée dans le public ».
Le franchiseur n’a d’ailleurs « pas laissé ses franchisés seuls » face aux mauvais commentaires sur les réseaux sociaux, mais leur a communiqué des éléments pour y répondre, ajoute la cour.
Enfin, certains franchisés ayant manifesté en 2019 et début 2020 leur intention de racheter la société franchiseur ou du moins la marque, « il paraît difficile de considérer que (celles-ci) étaient dévalorisées à leurs yeux au point de justifier une résolution du contrat de franchise. »
Les demandes du franchisé sont donc rejetées.
Le franchisé est condamné à verser 110 000 € à son ex-franchiseur en compensation de son préjudice financier
La cour d’appel de Rennes ne donne pas pour autant entière satisfaction à la société franchiseur.
Au vu des éléments dont elle a eu connaissance, elle confirme la décision de première instance ayant limité son préjudice financier à hauteur de 110 000 €, étant entendu que le reste de ses demandes sur ce point sont prescrites.
La cour estime par ailleurs qu’il n’a pas subi de préjudice d’image. Pour les juges, il n’est pas prouvé que le franchisé se soit vanté de ne pas payer ses redevances, ni qu’il ait critiqué publiquement les prestations de la société franchiseur.
Les juges refusent également de condamner le franchisé pour concurrence déloyale pendant le contrat. Si un constat d’huissier mentionne bien la création d’un site internet proposant des gammes de produits nouveaux sans l’accord du franchiseur, il ne met pas en évidence que la société franchisée aurait bien été en cause.
Quant à la clause de non-concurrence post-contractuelle qui n’aurait pas été respectée par le franchisé, les juges là encore rejettent la demande du franchiseur puisque les constats d’huissiers sont « antérieurs à la fin du contrat en litige ».
Le franchiseur gagne le procès, mais il est loin d’obtenir les 500 000 € qu’il réclamait. A ce jour, la marque existe encore mais, apparemment, ne franchise plus.