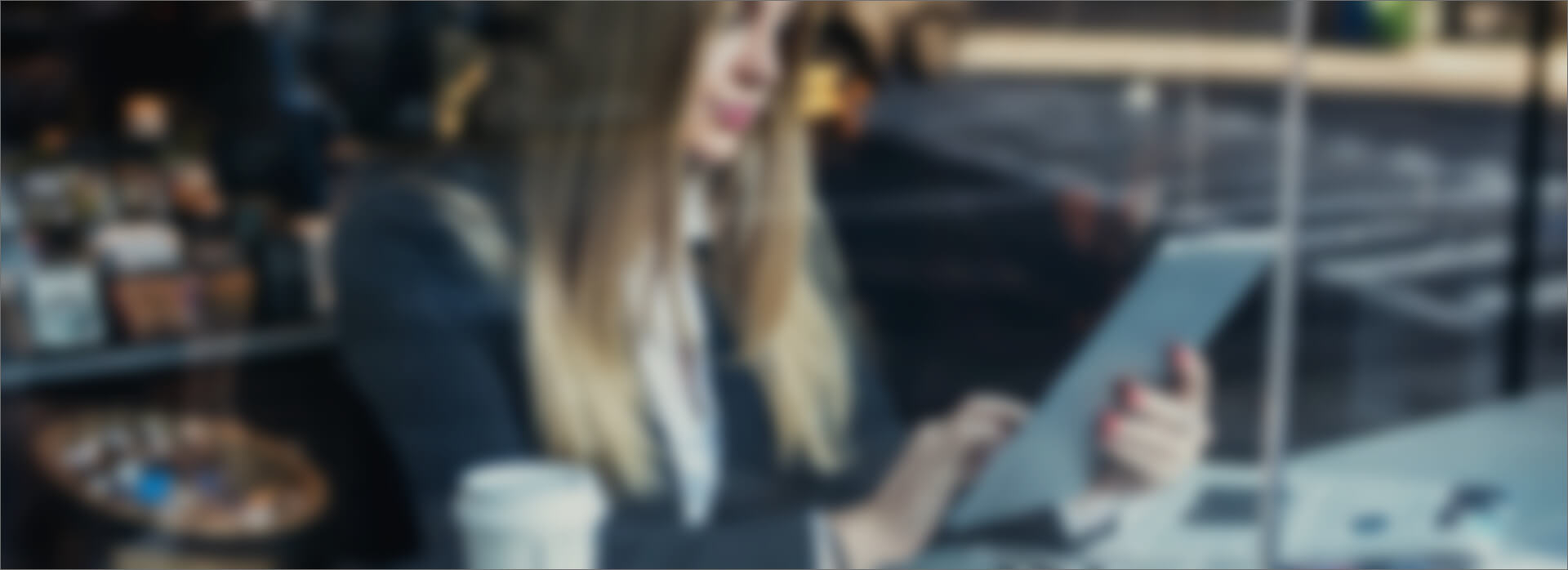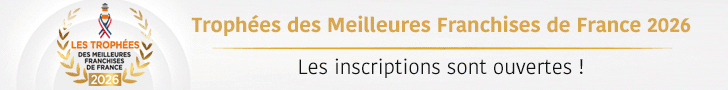Pour la réalité du contrat, tout dépend des intentions manifestées par les parties, répondent les juges. Pour son annulation, il faut savoir si le consentement du franchisé a été vicié par tromperie, manœuvre ou erreur sur la rentabilité.
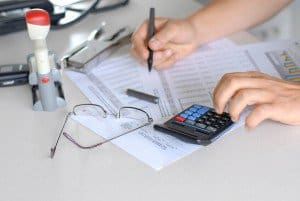
Dans cette affaire, un contrat de franchise n’a pas été signé entre les parties.
Toutefois, courant 2016, celles-ci se sont rapprochées pour envisager l’installation de deux boutiques à l’enseigne.
La première ouvre en mars 2018 après d’importants travaux de mise au concept, mais le chiffre d’affaires réalisé s’étant avéré plus faible que les prévisionnels établis, la société exploitante la ferme le 30 septembre suivant, six mois seulement après le démarrage.
En liquidation judiciaire, le commerçant estime avoir été trompé par l’enseigne avec laquelle il a collaboré
Estimant avoir été victime de graves manquements de la part de l’enseigne, la société exploitante l’assigne en justice en décembre 2018, avant d’être placée en liquidation judiciaire en octobre 2021.
En novembre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy estime qu’un contrat de franchise a bien été conclu entre les deux parties, mais que les fautes commises par l’enseigne ne sont « pas de nature à entraîner (sa) nullité ».
Les juges considèrent qu’ayant rompu unilatéralement la relation, la société franchisée a causé un préjudice à l’enseigne. Ils fixent à près de 200 000 € la créance du franchiseur au passif de la société franchisée.
Laquelle fait appel de la décision.
« Jamais signé », le contrat de franchise n’en a pas moins existé, estiment les juges
La cour d’appel de Chambéry confirme pour l’essentiel le jugement de première instance.
Les juges rappellent d’abord qu’un contrat de franchise, « qui demeure un contrat consensuel » n’a pas besoin d’être écrit pour exister.
Ils ajoutent que, dans le litige considéré, si un contrat de franchise « n’a jamais été signé », plusieurs pièces prouvent que les parties en avaient l’intention.
Elles ont échangé de nombreux courriels à propos d’un tel contrat et de ses conditions, la société du commerçant a installé l’enseigne, conduit des travaux d’aménagement de sa boutique aux normes de la marque avec la participation financière de celle-ci. Puis le commerçant a passé des commandes qui ont été livrées,
En outre, même si l’enseigne qualifiait son partenaire dans un courriel de « revendeur agréé », il s’agissait bien de franchise et non de distribution sélective puisque le projet de contrat indiquait qu’outre l’adoption de l’enseigne au fronton de sa boutique, le commerçant devrait exploiter l’activité « conformément au savoir-faire et/ou aux spécifications techniques susceptibles de lui être notifiés régulièrement par (elle) au cours de la durée du contrat ».
Enfin, le DIP (Document d’information précontractuel) remis « qualifiait de franchise le projet de contrat ».
« Ni tromperie, ni manœuvre dolosive, ni erreur sur la rentabilité » : le contrat de franchise n’est pas annulé par la cour d’appel
La cour écarte ensuite la nullité de ce contrat de franchise.
Le franchisé soutenait qu’il avait été trompé par l’enseigne sur la nature de leurs futures relations. Les juges rejettent cette accusation. Pour eux, les intentions des deux parties étaient clairement celles d’un contrat de franchise.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de ce contrat pour tromperie.
Le franchisé affirmait aussi que, dans la mesure où un DIP ne lui a été remis qu’en mai 2018, c’est-à-dire postérieurement à l’ouverture de la première boutique, il n’avait pas pu s’engager en connaissance de cause.
Comme les premiers juges, les magistrats de Chambéry écartent cet argument. Pour eux, étant donné « son expérience et sa qualité » professionnelles, le commerçant qui exploite déjà de nombreux magasins sous diverses enseignes « ne démontre pas en quoi le retard de communication du DIP aurait vicié son consentement ».
De même, la cour rejette l’erreur sur la rentabilité.
La société de l’exploitant « ne justifie pas de données qui lui auraient été communiquées par (la société franchiseur) sur la rentabilité de l’opération de franchise, de sorte qu’elle n’établit pas avoir été induite en erreur ».
Le jugement de première instance est donc confirmé « en ce qu’il a reconnu que le consentement (de la société franchisée) n’a pas été obtenu par dol, manœuvre dolosive ou erreur ».
La nullité du contrat de franchise est donc refusée.
La résiliation du contrat est prononcée aux torts exclusifs de la société franchisée, assortie de près de 200 000 € de créances au bénéfice de l’enseigne

Comme la société du franchiseur « n’a commis aucune faute », la société franchisée doit donc renoncer aux près de 400 000 € qu’elle réclamait au titre de la prise en charge de son passif ainsi qu’aux 525 000 € demandés pour le manque à gagner…
Elle voit également inscrite à son passif une somme d’un peu plus de 93 000 € de factures impayées, dues à l’enseigne. Plus 100 000 € pour le gain manqué par le franchiseur en raison de la rupture injustifiée survenue quatre ans et demi avant le terme envisagé dans le projet de contrat.
L’enseigne aurait voulu obtenir 700 000 € mais la cour a estimé que, si elle était « justifiée dans son principe », cette demande était surévaluée. D’autant « qu’aucune indemnité n’avait été fixée dans le projet de contrat en cas de résiliation aux torts du franchisé ».
L’enseigne n’obtient pas pour autant tout ce qu’elle réclamait
De même, comme une résiliation de contrat n’a pas d’effet rétroactif, le franchiseur ne peut pas obtenir ce qu’il réclamait, à savoir la mise au passif de la société franchisée du montant des frais qu’il a avancés pour la campagne publicitaire de lancement de la boutique, la campagne marketing, les travaux d’aménagement et les journées de formation des employés.
La société franchisante demandait encore 50 000 € d’indemnités pour atteinte à son image de marque en raison de la longue période pendant laquelle la boutique à l’enseigne est restée vide.
La cour estime « qu’aucune pièce n’établit le préjudice allégué ».
En revanche, la société du franchiseur est condamnée à verser près de 25 000 € à la société franchisée afin de respecter complètement son engagement contractuel à investir à hauteur de 50 % du coût de l’aménagement de la boutique.