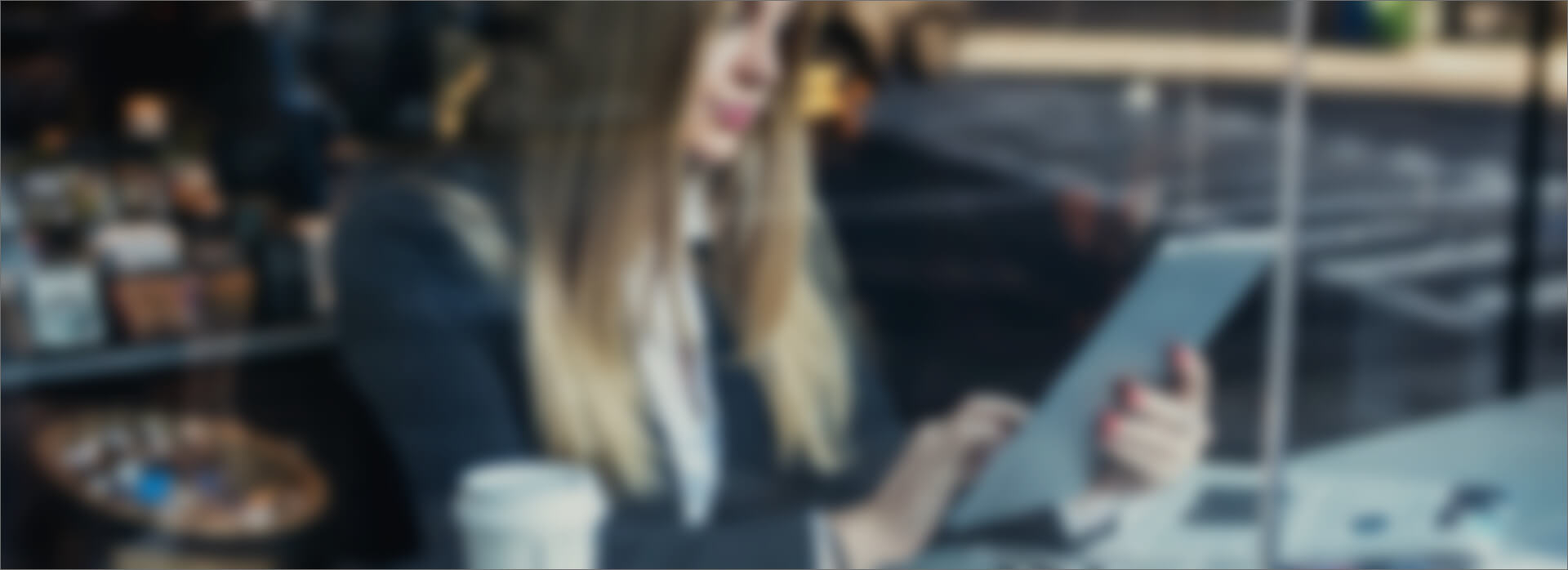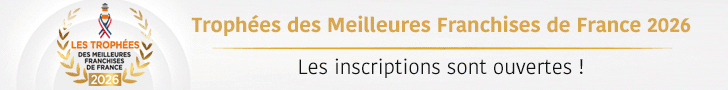La cour d’appel de Bordeaux avait refusé de requalifier un contrat de partenariat en contrat de gérance de succursale, car la commerçante avait disposé de certaines libertés dans son exploitation. Une décision révisée après intervention de la Cour de cassation.

Dans ce litige, le contrat est signé en juillet 2012 et le magasin ouvert au mois de septembre suivant. Il fixe pour la société partenaire un taux de commission de 40 % sur la vente des produits de l’enseigne.
Le compte d’exploitation prévisionnel transmis prévoit un chiffre d’affaires magasin de 264 000 € la première année, puis 300 et 350 000 € les années suivantes. Ce qui devrait se traduire par des commissions d’un montant voisin de 87 000, puis 100 000 et 117 000 €.
Des chiffres que la partenaire n’atteint pas, bien qu’elle explique avoir « travaillé 45 heures par semaine » et n’avoir « pris que 15 jours de congés » la première année. Selon son avocat, au terme de 17 mois, sa société n’a perçu de son activité que « 71 000 € de commissions, soit une différence de 62 % par rapport au prévisionnel ».
En juin 2015, la partenaire saisit le conseil des prud’hommes demandant qu’on lui reconnaisse le statut de gérante de succursale. En juillet, elle « prend acte » de la rupture de la relation de travail avec le commettant, « faute d’avoir perçu les salaires correspondants (à ce) statut ».
En septembre, sa société est placée en liquidation judiciaire.
Un parcours judiciaire à rebondissements
En 2018, les prud’hommes requalifient le contrat de partenariat en contrat de gérance de succursale et caractérisent la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une décision accompagnée d’une partie des indemnités réclamées par la plaignante.
Insatisfaites, les deux parties font appel.
En 2022, la cour d’appel de Bordeaux se prononce une première fois dans cette affaire et déboute la partenaire de ses demandes, infirmant le jugement des prud’hommes.
Pour les magistrats bordelais, il n’y avait pas lieu de requalifier le contrat de partenariat car la partenaire avait été, selon eux, libre de déterminer les conditions de fonctionnement et d’exploitation de sa boutique, notamment le recrutement des salariés, mais aussi son temps de travail, l’organisation et la répartition des tâches quotidiennes ainsi que les horaires d’ouverture du magasin.
En 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule pour l’essentiel cet arrêt d’appel, en raison de « motifs impropres à écarter la qualification de gérant de succursale ».
La cour d’appel de Bordeaux requalifie le contrat de partenariat
Corrigeant son arrêt de 2022, la cour d’appel de Bordeaux autrement composée suit donc cette fois l’indication donnée par la Cour de cassation et requalifie, comme en première instance, le contrat de partenariat en contrat de gérance de succursale.
Concernant d’abord le local commercial, les magistrats reconnaissent qu’il n’a pas été directement fourni par le commettant, que la commissionnaire était propriétaire du fonds de commerce et titulaire du bail commercial, qu’elle a été laissée libre de choisir ses artisans afin de réaliser l’aménagement.
Mais cela ne change rien, précisent-ils, au fait que son local « a été aménagé aux couleurs (de) l’enseigne et agréé (par la société commettante) », première condition pour que s’applique l’article L.7321-2 du code du travail.
La cour considère ensuite, après un examen détaillé du contrat de partenariat, que la société commettante « imposait les conditions et les prix de vente (de ses) produits à la société (commissionnaire) ».
Certes, celle-ci avait la possibilité « de mettre en place des opérations spécifiques hors les soldes et les promotions décidées par (l’enseigne) ».
Mais cela est « insuffisant à caractériser une politique personnelle des prix », en particulier compte-tenu du fait qu’elle était obligée dans ce cas « d’obtenir un accord préalable écrit de la société (commettante) et de supporter le reste à charge. »
Pour la cour, la commissionnaire « se trouvait dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société commettante »

En outre, si le contrat garantissait bien une exclusivité territoriale au point de vente, il exigeait aussi que la partenaire s’interdise de vendre les produits en dehors de celui-ci, qu’il s’agisse de ventes privées, de vente par correspondance ou en ligne, dans d’autres points de vente ou sur les marchés.
Pour la cour d’appel de Bordeaux, la commissionnaire « se trouvait (donc) dans une situation de dépendance économique vis à vis de la société (commettante), de sorte que les conditions prévues par l’article L.7321-2 du code du travail étaient réunies. »
Et le fait qu’elle ait « organisé ses horaires à sa guise et géré seule et sous sa seule responsabilité le personnel de la boutique », n’y change rien, « dès lors (…) qu’elle vendait des marchandises qui lui étaient fournies presque exclusivement par la société (commettante), aux conditions et aux prix imposés par (celle-ci), dans un local agréé par (l’enseigne) ».
La tête de réseau est condamnée à verser à son ex-partenaire des rappels de salaires et de congés pour plus de 66 000 €
Le contrat de partenariat étant requalifié en contrat de gérance de succursale, la cour condamne la tête de réseau à verser à son ex-partenaire plus de 60 000 € de rappels de salaires assortis de plus de 6 000 € de congés payés afférents.
Les magistrats déterminent leur calcul en prenant pour base le salaire d’un agent de maîtrise responsable de magasin indiqué dans la convention collective du secteur d’activité, soit 1 860 € bruts mensuels (multiplié ici par 33 mois). Niveau admis par la société commettante elle-même.
Les juges refusent en effet de se baser sur le salaire d’un cadre (de l’ordre de 3 000 € bruts mensuels) comme le souhaitait la plaignante car, selon eux, celle-ci n’avait « pas (eu) de lien de subordination » avec la société commettante.
La rupture est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et assortie d’indemnités de l’ordre de 16 000 €
Concernant la rupture de la relation, le commettant considère qu’il s’agit de la part de la commissionnaire, d’une démission, ne lui ouvrant donc aucun droit à indemnités.
Ce n’est pas l’avis des magistrats pour qui, au contraire, cette rupture « doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Pour la cour, « le non règlement du salaire » (par le commettant) constituait en effet « un manquement suffisamment grave pour rendre la poursuite de la relation de travail impossible. » La commissionnaire était donc dans son droit de « prendre acte » de la rupture pour ce motif.
Et peu importe, précisent les juges, que des commissions sur le chiffre d’affaires aient été versées par la société commettante à la société commissionnaire, il reste que la gérante, elle, « n’a pas perçu de salaire pendant toute la relation contractuelle ».
La cour condamne en conséquence la société commettante à verser à l’ex-commissionnaire des indemnités de préavis et de licenciement d’un peu plus de 5 000 € ainsi que des dommages et intérêts de plus de 11 000 € pour « rupture sans cause réelle et sérieuse ».
Elle refuse en revanche d’accorder à l’ex-partenaire une compensation pour les heures supplémentaires qu’elle a effectuées, puisque les conditions de travail et les horaires n’ont pas été fixés par la société commettante.
Enfin, les magistrats estiment qu’il n’y a pas lieu d’accorder à l’ex-partenaire une compensation pour préjudice moral qu’elle « ne justifie pas ». Ils n’ont pas été sensibles à ses arguments sur la « mise entre parenthèses de sa vie professionnelle et personnelle » qu’elle n’aurait « pas subie si ses droits avaient été respectés ».