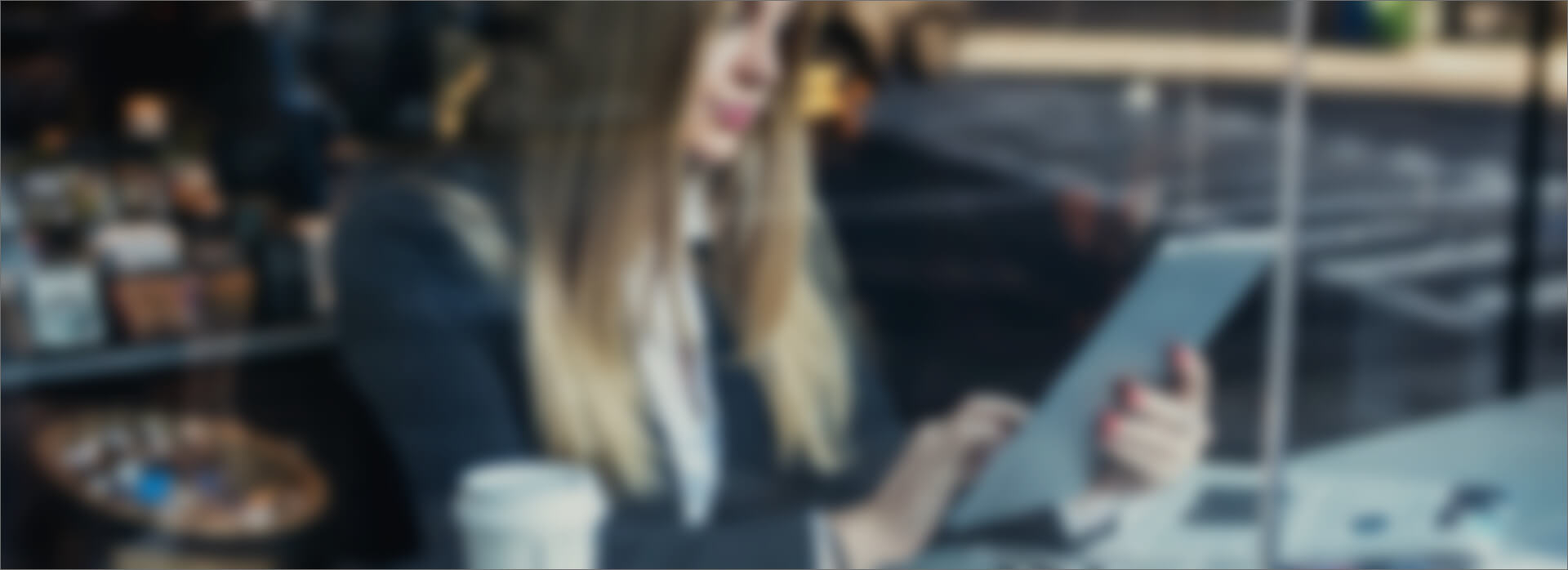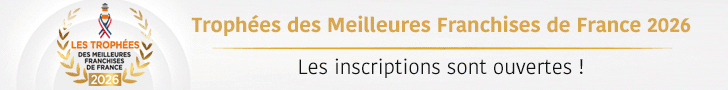Si un dirigeant de réseau propose un contrat de licence de marque tout en transmettant un savoir-faire et en assurant une assistance à son partenaire, il fait en réalité de la franchise… Et si en plus, il ne transmet pas les informations précontractuelles prévues par la loi, il risque de voir son contrat annulé.
Par un arrêt du 6 mai 2025, la cour d’appel de Toulouse a requalifié un contrat de licence de marque en contrat de franchise et annulé ce dernier.
Dans ce litige, une société souhaitant se développer en réseau de commerce associé signe en décembre 2019 avec un partenaire un contrat de licence de marque.
Ce contrat doit durer un an (du 6 janvier au 31 décembre 2020) et se prolonger par un contrat de franchise dont le projet est annexé au contrat de licence de marque.
En contrepartie de l’utilisation de la marque, le licencié s’acquitte d’un droit d’entrée de 20 500 € et de redevances au long de son contrat.
Le chiffre d’affaires et la rentabilité espérées n’étant pas au rendez-vous, le licencié annonce à la tête de réseau en octobre 2020 sa décision de cesser son partenariat au 31 décembre et quelques mois plus tard l’assigne en justice.
Pour les juges, le contrat de licence de marque était en réalité un contrat de franchise
En décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse requalifie le contrat de licence de marque en contrat de franchise et annule celui-ci, condamnant le chef de réseau à reverser à son ex-partenaire 34 200 € correspondant au droit d’entrée et aux redevances qu’il a payées.
Le chef de réseau fait appel de cette décision.
Devant la cour d’appel de Toulouse, le dirigeant conteste à la fois la requalification du contrat de licence de marque et son annulation.
Il affirme que son partenaire était « parfaitement informé » de la nature du contrat qu’il signait et qu’il en a « volontairement exécuté les termes », « de sorte qu’il n’est pas fondé à en invoquer la nullité a posteriori ».
Il estime en outre que le consentement du licencié n’a « pas été vicié ».
La cour d’appel de Toulouse ne le suit pas dans cette argumentation et confirme en tous points le jugement du tribunal de commerce.
Transmission de savoir-faire et assistance continue : c’était de la franchise !
Les magistrats rappellent d’abord la différence entre licence de marque et franchise :
« Le contrat de licence de marque est celui par lequel le concédant autorise l’exploitation d’une marque à un licencié, moyennant versement d’une contrepartie ». Tandis que « Le contrat de franchise implique la transmission au profit du franchisé d’un savoir-faire, de signes distinctifs et d’une assistance continue. Si l’un de ces trois éléments fait défaut, le contrat ne pourra pas être qualifié de contrat de franchise. »
Or, notent les juges, le contrat de licence de marque signé en décembre 2019 comporte une description du concept et « détaille le savoir-faire » développé par le concédant. Il y est indiqué également que celui-ci « entend promouvoir et exploiter à court terme ce concept par l’intermédiaire d’un réseau de franchise ».
Mais surtout, un contrat de formation initiale est signé le même jour entre les parties, prévoyant 12 jours obligatoires de formation payante. Une « transmission de savoir-faire » qui « va en conséquence au-delà de la simple exploitation d’une marque », selon la cour.
En outre, relèvent les juges, « le montant de la redevance prévue dans le cadre du contrat de licence de marque est strictement identique à celui convenu dans le cadre du contrat de franchise à venir ».
Par ailleurs, « il ressort des pièces communiquées par les parties, et notamment des échanges de courriers électroniques, que dans le cadre de l’exécution du contrat de licence de marque, de nombreuses réunions et journées de formation obligatoires étaient prévues. »
Conséquence : « le contrat de licence de marque, qui impliquait la transmission d’un savoir-faire ainsi qu’une assistance, a été requalifié de contrat de franchise à bon droit par les premiers juges. »
Pour la cour d’appel, le consentement du partenaire a été « vicié », le contrat est annulé

Ensuite, ils considèrent que le consentement du licencié a été « vicié ».
Ils relèvent que la société tête de réseau reconnaît ne pas avoir transmis à son futur partenaire les informations précontractuelles prévues par la loi (articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce).
Les juges considèrent également que les informations figurant alors sur le site internet du franchiseur étaient « parcellaires » et « en partie fausses ».
Ainsi, il indiquait qu’avec un investissement de départ de 25 000 €, il était possible d’atteindre après deux ans un chiffre d’affaires compris entre 70 et 120 000 €.
Or, le droit d’entrée étant déjà de 20 500 € et le taux de redevances mensuel de 7 % sur le CA, le concept coûtait bien plus cher qu’indiqué. D’ailleurs, en 10 mois, le plaignant a dépensé 34 200 € en droit d’entrée et redevances…
Et « la question de la rentabilité économique de l’opération réalisée était déterminante pour la société (partenaire) ».
En conséquence « le défaut de délivrance des informations précontractuelles requises en matière de franchise, est venu vicier le consentement de la société (partenaire) et de son dirigeant. »
La cour confirme le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat et condamné le dirigeant de réseau à reverser 34 200 € à son ex-partenaire licencié (et en fait franchisé !).
En revanche, comme le tribunal de commerce, la cour d’appel n’accorde pas de dommages et intérêts à l’ex-licencié pour le préjudice subi.